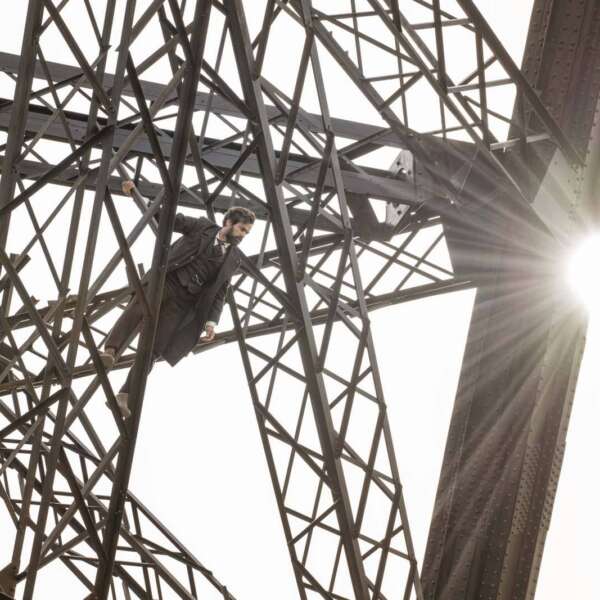Une fois de plus Netflix sera, en cette année bien singulière pour le 7ème art, le laboratoire attitré des grands cinéastes contemporains. Six (très) longues années après Gone Girl, David Fincher rejoint Martin Scorsese, Damien Chazelle, et autres Spike Lee dans le club des grosses références de la plateforme star pour y diffuser sa réalisation la plus intimiste jusqu’alors : Mank. Et pour cause, l’homme derrière le scénario n’est autre que son papa, décédé en 2003.
« On ne résume pas la vie d’un homme en deux heures, au mieux on en donne un aperçu. »
Herman J. Mankiewicz
Voilà qui résume grossièrement l’intention première du film, qui s’attache à retranscrire un morceau de la vie de Herman J. Mankiewicz, dit “Mank”, scénariste – alcoolique certes, mais – oscarisé pour le légendaire Citizen Kane. Et c’est là que je vous explique en quoi le chef d’œuvre d’Orson Welles est devenu, en 1941, l’ovni qui a chamboulé l’industrie tout entière.
Projet méta par excellence
Citizen Kane raconte l’enquête par le journaliste Jerry Thompson sur la mort du richissime éditeur de journaux Charles Foster Kane et sur le dernier mot prononcé par celui-ci avant qu’il ne succombe : “Rosebud”. Ponctué de nombreux flashbacks sur la vie de Kane, le film de Welles avait pour projet de dénoncer la figure de William Randolph Hearst, grand magnat des médias et de la presse, et surtout l’influence que ce Bolloré en puissance du XXème siècle pouvait avoir sur les décisions politiques.
Nous voici donc plongés dans les années qui précédent la création de Citizen Kane entre la perversité reluisante des studios de la MGM et le faste des soirées mondaines organisées dans le Hearst. Au moment même où notre héros (Gary Oldman, formidable) prend conscience de sa capacité à pouvoir faire basculer les puissants grâce à ses scripts. Plus cinéphile que ça, tu meurs.
Moins centré sur l’écriture de Citizen Kane que sur le personnage de Mankiewicz, l’œuvre de Fincher s’inscrit ainsi dans une mise en lumière de la profession de scénariste, souvent niché dans l’ombre du réalisateur mais rôle-clé dans la capacité d’un film à toucher son public. Intention largement louable pour un cinéaste qui n’a jamais été à l’origine d’aucun de ses scénarios. De là à y voir le portrait de son propre père à travers le personnage de Mank, il n’y a qu’un pas qu’on lui reconnaît sans peine. Quant à la suggestion même de se confondre avec Orson Welles…je vous laisse en juger par vous-même.
Un seul être vous Mank…
A travers l’immersion qu’il propose dans le Hollywood des années 30, Fincher n’est guère très loin de la démarche d’un Once upon a time in Hollywood chez Tarantino. Pourtant, si le second continue à tourner en pellicule, le premier, fidèle à ses principes, a fait le choix du numérique ici encore, préférant travailler sa patine rétro directement en post-prod.
Du reste, on s’étonnera de l’humeur assez platonique et d’une mise en scène assez timide faisant la part belle aux plans fixes. Comme si Fincher junior s’imposait volontairement une prise de recul sur le travail de Fincher senior, ne cherchant jamais à dénaturer le scénario de son paternel. Posture honorable certes, mais qui sert davantage l’hommage plutôt que l’adaptation mordante à laquelle on s’attendait.
Et puis, il y a cette fausse bonne idée que représente l’effet “brûlure de cigarette” dans le coin supérieur droit de l’écran. Originalement censé rappeler les changements de pellicule et évoquer l’aspect factice d’un propos servi en long-métrage, il amène finalement plus de confusion qu’autre chose. Dommage…
Carte blanche from Netflix
Après une première approche à la real quelques épisodes de House of Cards, puis une collaboration plus officielle avec Mindhunter, David Fincher s’est donc saisi de la nouvelle main tendue par Netflix pour y produire, littéralement, ce qu’il veut. Au risque, comme on pouvait s’y attendre, d’être en décalage avec les attentes du public visé.
Car là où le cinéaste surprend, ce n’est pas nécessairement dans sa mise en scène plus convenue qu’à l’ordinaire, mais dans sa fâcheuse tendance à garnir son récit d’une foultitude d’informations à coup de name dropping et de dialogues éclairs. Largement de quoi combler les initiés, mais malheureusement au détriment d’une large portion du public qui aura tôt fait d’abandonner. Ajoutez à cela de belles longueurs et vous larguez les derniers encore debout.
Et si quelques séquences comme la soirée des élections ou encore le dîner chez Hearst offrent malgré tout leur moment de grâce, elles ne parviendront jamais à rééquilibrer les compteurs du standard Fincher auquel on est habitué. A l’arrivée, celui-ci nous offre un film diablement bien réalisé et esthétiquement impeccable, mais qui ne parle qu’à lui. Nous, on préfèrera garder en mémoire la beauté du geste en signe d’héritage, et le nom de Jack Fincher crédité pour la toute dernière fois en tant que scénariste.